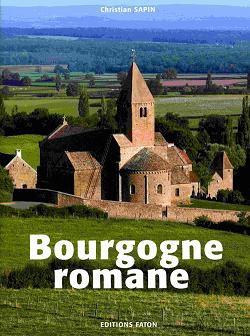|
|
La
Rochepot
|
Edifice |
Eglise
Notre-Dame-de-la-Nativité, ancienne priorale Saint-Georges |
| Situation |
Centre
village, 21340 (Côte d’Or) |
|
Parties
Romanes |
Nef,
transept, abside et absidioles |
| Décoration |
Décor
du portail ouest, chapiteaux historiés, arcatures de
l’abside, pilastres cannelés |
|
Datation |
Milieu
du 12e siècle |
Introduction
- Historique - Description
- Visite
 Introduction
Introduction
Le très
beau village de La Rochepot en Côte d’Or est dominé
par le château fort se trouvant sur un éperon rocheux
et formant, avec la belle église romane, un site très
charmant. On se trouve ici à mi-chemin entre Autun
et Beaune, et l’influence des deux
grandes églises voisines est manifeste sur l’église
 Notre-Dame-de-la-Nativité
qui en est à peu près contemporaine. L’église
du deuxième quart du 12e siècle, autrefois priorale
dépendant de l’abbaye de Flavigny,
reprend le profil brisé des arcades et les pilastres cannelées
d’Autun. Malheureusement, l’édifice
a été mutilé pendant des siècles et
aujourd’hui la nef est privée de sa voûte et
le transept, dont la croisée était autrefois surmontée
d’un clocher, est partiellement reconstruit. Puis l’église
a encore été fortement restaurée au 19e siècle.
Cependant, l’église de La Rochepot reste très
intéressante pour ses chapiteaux, décorant le portail,
les piliers de la nef, et les arcatures de l’abside, inspirés
par ceux de la cathédrale d’Autun
et ceux de Saint-Andoche de Saulieu. On
trouve quelques scènes historiées et plusieurs motifs
végétaux d’une belle ordonnance. Après
la visite de l’église, on peut aller visiter le château
féodal, l’un des châteaux les plus connus de
Bourgogne avec ses toits remarquables en tuiles polychromes et sa
situation pittoresque au-dessus du village. C’est un château
commencé au 13e siècle, reconstruit au 15e siècle
par la famille Pot, détruit à la Révolution
puis reconstruit vers 1900 par Sadi-Carnot. Un peu au nord
se trouvent les vestiges du vieux château
primitif. La Rochepot se trouve également sur le circuit
des églises de la Côte de
Beaune. Notre-Dame-de-la-Nativité
qui en est à peu près contemporaine. L’église
du deuxième quart du 12e siècle, autrefois priorale
dépendant de l’abbaye de Flavigny,
reprend le profil brisé des arcades et les pilastres cannelées
d’Autun. Malheureusement, l’édifice
a été mutilé pendant des siècles et
aujourd’hui la nef est privée de sa voûte et
le transept, dont la croisée était autrefois surmontée
d’un clocher, est partiellement reconstruit. Puis l’église
a encore été fortement restaurée au 19e siècle.
Cependant, l’église de La Rochepot reste très
intéressante pour ses chapiteaux, décorant le portail,
les piliers de la nef, et les arcatures de l’abside, inspirés
par ceux de la cathédrale d’Autun
et ceux de Saint-Andoche de Saulieu. On
trouve quelques scènes historiées et plusieurs motifs
végétaux d’une belle ordonnance. Après
la visite de l’église, on peut aller visiter le château
féodal, l’un des châteaux les plus connus de
Bourgogne avec ses toits remarquables en tuiles polychromes et sa
situation pittoresque au-dessus du village. C’est un château
commencé au 13e siècle, reconstruit au 15e siècle
par la famille Pot, détruit à la Révolution
puis reconstruit vers 1900 par Sadi-Carnot. Un peu au nord
se trouvent les vestiges du vieux château
primitif. La Rochepot se trouve également sur le circuit
des églises de la Côte de
Beaune.
| |
|
|
L’église de la Rochepot vue
depuis le château |
 Historique
Historique
 L’église
était celle d’un prieuré bénédictin
fondé par l’abbaye de Flavigny
à une époque inconnue. Seule vestige du prieuré
disparu est la priorale dédiée autrefois à
Saint-Georges. Cette église romane a été vraisemblablement
construite vers le milieu du 12e siècle. Le prieuré
dépend de Couches depuis le début
du 14e siècle. En 1352, les seigneurs du château fondent
une chapelle dédiée à Sainte-Cathérine
dans le croisillon nord de la priorale. C’est au 15e siècle
que l’église fut gravement incendiée : les voûtes
de la nef et peut-être le clocher de la croisée sont
détruits. Le clocher fut alors reconstruit à droite
de la façade à la fin du 15e siècle. Les moines
se retirent au monastère de Couches
au début du 16e siècle. L’église fut alors
rattachée à la paroisse de Baubigny
avant de devenir une paroissiale indépendante sous le vocable
de Notre-Dame-de-Nativité à partir de 1654. L’église
est remaniée durant les siècles suivants : les clôtures
de la chapelle seigneuriale furent détruites vers 1740, d’importantes
restaurations seront effectuées en 1776 (charpentes et couvertures),
en 1783 (contrefort) et puis en 1870-1875 (absidioles et portail
ouest). L’église classée Monument Historique
en 1909. La dernière campagne de restauration par les Monuments
Historiques date de 1970-1976 (couverture, murs, badigeons, charpentes). L’église
était celle d’un prieuré bénédictin
fondé par l’abbaye de Flavigny
à une époque inconnue. Seule vestige du prieuré
disparu est la priorale dédiée autrefois à
Saint-Georges. Cette église romane a été vraisemblablement
construite vers le milieu du 12e siècle. Le prieuré
dépend de Couches depuis le début
du 14e siècle. En 1352, les seigneurs du château fondent
une chapelle dédiée à Sainte-Cathérine
dans le croisillon nord de la priorale. C’est au 15e siècle
que l’église fut gravement incendiée : les voûtes
de la nef et peut-être le clocher de la croisée sont
détruits. Le clocher fut alors reconstruit à droite
de la façade à la fin du 15e siècle. Les moines
se retirent au monastère de Couches
au début du 16e siècle. L’église fut alors
rattachée à la paroisse de Baubigny
avant de devenir une paroissiale indépendante sous le vocable
de Notre-Dame-de-Nativité à partir de 1654. L’église
est remaniée durant les siècles suivants : les clôtures
de la chapelle seigneuriale furent détruites vers 1740, d’importantes
restaurations seront effectuées en 1776 (charpentes et couvertures),
en 1783 (contrefort) et puis en 1870-1875 (absidioles et portail
ouest). L’église classée Monument Historique
en 1909. La dernière campagne de restauration par les Monuments
Historiques date de 1970-1976 (couverture, murs, badigeons, charpentes).
 Description
Description
L’église
en calcaire blanc a été très remaniée
au cours des siècles mais le plan de l’édifice
du 12e siècle est toujours existant : une nef de quatre travées
flanquées de bas-côtés étroits, puis
un transept bas et saillant suivi directement par l’abside
entre deux absidioles. L’extérieur de l’église
a été fortement remanié. Le clocher
qui flanque la nef côté sud est de la fin du 15e siècle
et sa flèche est de 1822. Peut-être un clocher roman
se trouvait à l’origine sur la croisée. La sacristie
au sud du transept est de 1860. La façade ouest est percée
d’une baie centrale et d’un grand portail
sévèrement restauré au 19e siècle. Le
grand tympan nu et son trumeau sont modernes et le décor
a été partiellement remplacé par des copies.
Il conserve ses quatre colonnes avec chapiteaux feuillagés
supportant des voussures dont l’archivolte présente un joli
décor d’oves. Le flanc nord de la nef conserve encore des
baies romanes et un ancien portail muré indiquant peut-être
l’emplacement de l’ancien cloître disparu, tandis que les
contreforts ont été refaits. On regarde encore l’harmonie
des absides du chevet et leurs couvertures en lave.
| |
Photo : don à Bourgogne
Romane |
Extérieur
de l’église |
|
|
|
|
|
| Ensemble |
Chevet |
Absides |
Clocher |
|
|
|
|
| Nef |
Transept |
Façade |
Façade |
|
|
|
|
| Portail |
Tympan |
Archivolte |
Chapiteaux |
Entrons dans la nef, sans éclairage direct,
dont les voûtes mutilées au 15e siècle sont
remplacées par des lambris. On remarque la structure autunoise
des piliers de plan carré, flanqué de pilastres cannelés
et de colonnes engagées qui supportent les grandes arcades
à double rouleau de profil brisé. Les hauts pilastres
aux entablements modernes soutenaient la voûte sans doute
en berceau brisé sur doubleaux. Les bas-côtés
étroits ont également perdus leurs voûtes et
celui du côté sud est partiellement reconstruit à
la fin du 15e siècle. Des lambris ont remplacés les
voûtes en demi-berceaux dont on retrouve encore les pilastres
des murs latéraux et les vestiges de doubleaux au nord. Le
transept reprend l’architecture de la nef avec
cependant deux piliers cruciformes supportant les arcades brisées.
Les croisillons conservent leurs voûtes d’arêtes
et s’ouvrent sur les absidioles en cul-de-four.
L’abside centrale s’ouvre sous un arc
triomphal brisé retombant sur des pilastres cannelés.
Elle est décorée par cinq arcatures entourant les
trois baies, retombant sur deux colonnettes lisses, deux colonnettes
torsadées et deux pilastres cannelés. Quelques vestiges
de fresques y sont à voir. Il y a également une fresque
de Saint-Jean-Baptiste du 16e siècle dans cette église.
|
|
|
|
|
| Nef |
Arcades |
Pilier |
Abside |
|
|
|
|
| Bas-côté |
Bas-côté |
Bas-côté |
Transept |
|
|
|
|
| Arcatures |
Pilastre |
Pilastre |
Absidiole |
Les
chapiteaux de cette église méritent
une visite approfondie. Leurs sculptures s’inscrivent parfaitement
dans le style courant du milieu du 12e siècle. On n’y
trouve pas la qualité des sculptures d’Autun
ou de Saulieu, mais le maître
sculpteur s’est inspiré sans doute de ces grandes églises
voisines. Sur les chapiteaux des colonnes engagées de la
nef on trouve vingt chapiteaux dont trois scènes historiées
aux personnages allongés. Sur le premier pilier nord, l’Annonciation,
avec l’ange Gabriel qui apparaît à la Vierge Marie,
et sur la face gauche du chapiteau une femme reposant sa tête
sur sa main représentant peut-être le sommeil de la
Vierge. Sur le deuxième pilier sud, le combat d’un
guerrier à cheval contre un aigle, où il s’agit
peut-être de saint Georges. Sur l’autre face du même
pilier, Balaam sur l’ânesse arrêté par l’ange,
portant son épée, sujet qu’on retrouve à
Saulieu et au portail d’Autun.
Sur les autres chapiteaux on trouve des décors végétaux
avec parfois des têtes : un beau feuillage, deux personnages
en buste, une tête couronnée. Sur les extrémités
des bas-côtés, deux couples de chapiteaux représentent
deux fois une tête léonine et deux fois un arbre en
Y avec deux volutes issus d’un même tronc et des palmettes
d’angle. Les autres chapiteaux sont sculptés de feuilles
lisses et nervurées, ou simplement épannelés.
Les chapiteaux sont en calcaire, à l’exception des chapiteaux
en grès dans le transept et dans les parties orientales de
la nef, qui sont peut-être plus tardives. Les tailloirs sont
souvent décorés de perles ou de disques plats. Dans
l’abside, les chapiteaux des arcatures sont sculptés de décors
végétaux et d’un masque.
Images des chapiteaux
:
|
| |
|
|
|
| Annonciation |
Balaam arrêté
par l’ange |
Combat de
guerrier et aigle |
Personnages
en buste |
| |
|
|
|
| Tête
couronnée |
Tête
léonine (1) |
Tête
léonine (2) |
Feuillage |
| |
|
|
|
| Arbre
en Y (1) |
Arbre en Y
(2) |
Feuilles lisses
|
Chapiteau épannelé |
| |
|
|
|
| Décor
végétal (abside) |
Masque (abside) |
Décor
végétal (abside) |
Décor
végétal (abside) |
 Visite
Visite
L’église
se visite librement.
Pour en savoir
plus sur La Rochepot, vous pouvez visiter sur internet:
Site du village
: http://mairiedelarochepot.free.fr/.
Site
sur le château : http://www.larochepot.com/.
Page lieux sacrés : http://lieuxsacres.canalblog.com/archives/la_rochepot__21_cote_d_or_/index.html.
Page petit patrimoine : http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=21527_2.
Page wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Notre-Dame-de-la-Nativit%C3%A9_de_La_Rochepot.
Page de photos : http://pormenaz.free.fr/La-Rochepot.php.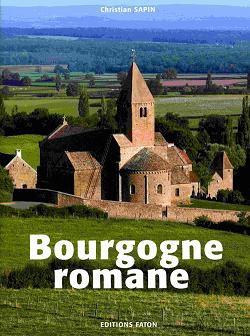
Remerciements
: les photos de la page sont en partie de Cees
van Halderen.
Aussi, vous pouvez consulter :
- Oursel R.,
Bourgogne Romane, Zodiaque, La Nuit des temps 1.
- Sapin C., Arnaud C. et Berry W., Bourgogne Romane, Dijon,
2006.
- Stratford N., L’église Saint-Georges de La Rochepot,
Paris, 1998.
[haut
de page] [accueil] [contact]
|


 Notre-Dame-de-la-Nativité
qui en est à peu près contemporaine. L’église
du deuxième quart du 12e siècle, autrefois priorale
dépendant de l’abbaye de
Notre-Dame-de-la-Nativité
qui en est à peu près contemporaine. L’église
du deuxième quart du 12e siècle, autrefois priorale
dépendant de l’abbaye de 
 L’église
était celle d’un prieuré bénédictin
fondé par l’abbaye de
L’église
était celle d’un prieuré bénédictin
fondé par l’abbaye de