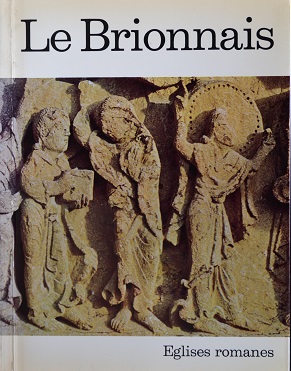|
Introduction - Historique - Description - Visite
Ce village du Brionnais conserve une église romane avec un fier clocher et un décor sculpté intéressant. Elle dépendait de Cluny et remonte au début du 12e siècle. Seul le transept et le chœur sont encore romans, puisque la nef a été reconstruite au 19e siècle. Le haut clocher de la croisée, suivant la tradition régionale de Vareilles et de Varenne-l’Arconce, conserve trois étages de baies avec demi-colonnes. Le chevet est de belle facture avec ses trois absides et ses pignons. A l’intérieur, les formes sont encore tous en plein cintre. La croisée est couverte d’une coupole et une travée avec bas-côtés précède l’abside décorée d’arcatures. La sculpture des chapiteaux de la croisée et de plusieurs bases de colonnes est originale. Les thèmes végétaux, humains ou animaliers sont les œuvres d’un atelier qui travaillait également à Vauban et aux portails de l’église de Châteauneuf. Les tailloirs ont reçu un décor rare de séries de têtes. Quelques modillons à l’extérieur sont également sculptés de têtes.
Des sarcophages de l’époque mérovingienne contigus aux fondations de l’église sont la preuve de l’ancienneté du lieu. Une église paroissiale fut donnée à Cluny en 1037 par Archimbaud Le Blanc, vicomte de Mâcon. De retour de Jérusalem, en 1039, il donne d’autres domaines sous la condition que Cluny y installe un prieuré. Un petit prieuré clunisien y est attesté au début du 12e siècle, époque de la construction de l’église. Saint-Laurent dépendait alors du bailliage et du diocèse de Mâcon, de l’archiprêté de Beaujeu et de la châtellenie de Châteauneuf. Le prieuré fut probablement détruit vers 1570 par les troupes protestantes. La nef romane fut détruite en 1845 pour être remplacée par une grande nef à bas-côtés, construite en 1846 selon les plans de l’architecte Berthier. Classée Monument Historique en 1874, l’église fut restaurée de 1877 à 1879 par Selmersheim, qui répare le chœur roman et refait plusieurs sculptures.
L’église comprend une partie orientale romane et une large nef moderne. La nef de style néo-roman, avec quatre travées voûtées d’arêtes et deux portails aux tympans sculptés, ne présente aucun intérêt artistique. La partie romane est du début du 12e siècle, peut-être des années 1120. Elle se compose d’un transept bas et non-saillant, d’un chœur avec travée droite flanquée de bas-côtés, d’une abside et de deux absidioles. Le clocher s’élève sur la croisée du transept.
Le décor extérieur de l’église se concentre sur le clocher. Il s’élève sur trois étages, en retrait l’un sur l’autre, séparés par des cordons ornés de perles. Les quatre faces sont flanquées de demi-colonnes verticales. La base s’ouvre par des baies simples. L’étage intermédiaire présente de larges baies sur colonnettes à chapiteaux. L’étage supérieur, entièrement restauré, a des baies géminées avec triples colonnettes et des modillons. Le chœur et les croisillons sont terminés par des pignons. Les modillons du chœur conservent quelques têtes humaines, tandis que ceux des absides sont nus.
L’intérieur de la partie romane est restauré. Dans le transept, une coupole sur trompes est portée par quatre arcs en plein cintre à double rouleau retombant sur des piliers cruciformes à colonnes engagées. Les croisillons, voûtés en berceau, s’ouvrent vers les bas-côtés de la nef et vers ceux du chœur par des arcs en plein cintre. La travée de chœur et ses bas-côtés, voûtés en berceau également, sont séparés par de grandes arcades à double rouleau sur colonnes engagées. L’abside restaurée a trois baies qui s’inscrivent dans cinq arcatures sur colonnettes. Les absidioles sont dépourvues de décor.
Les sculptures de la partie romane, partiellement refaites au 19e siècle, méritent l’attention. Sur les chapiteaux de la croisée on rencontre deux fois le thème du baiser de paix, avec des personnages en couple sortant des feuilles. Deux autres chapiteaux représentent des bergers et des animaux. Les tailloirs sont décorés de têtes de morts ou d’autres motifs. D’autres chapiteaux romans sont décorés de feuillages simples ou de têtes humaines. Les chapiteaux de la nef sont modernes, avec, encadrant l’entrée du transept, deux reproductions de chapiteaux d’Anzy-le-Duc (Samson maitrisant un lion et saint Michel combattant un ange). Quelques bases de colonnes conservent également un décor roman original, montrant des animaux frustes entre des motifs végétaux. On y retrouve des animaux encadrant une croix entrelacée, un lapin et un âne mangeant des feuilles, un serpent entrelacé, et le roi et la reine tenant un sceptre (restauré).
Pour en savoir plus sur Saint-Laurent-en-Brionnais, vous pouvez visiter les sites Internet suivants : Page Lieux Sacrés : http://lieuxsacres.canalblog.com/archives/saint_laurent_en_brionnais__71_saone_et_loire_/index.html. Remerciements
: les photos de la page sont de Cees
van Halderen. Vous pouvez également consulter les références suivantes : - Hammann
M., Die Burgundische Prioratkirche von Anzy-le-Duc und die romanischen
plastik im Brionnais, Wurzburg, 1998.
[haut de page] [accueil] [contact]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||